Boal A., Théâtre de l'opprimé
Théâtre de l’opprimé
Augusto Boal
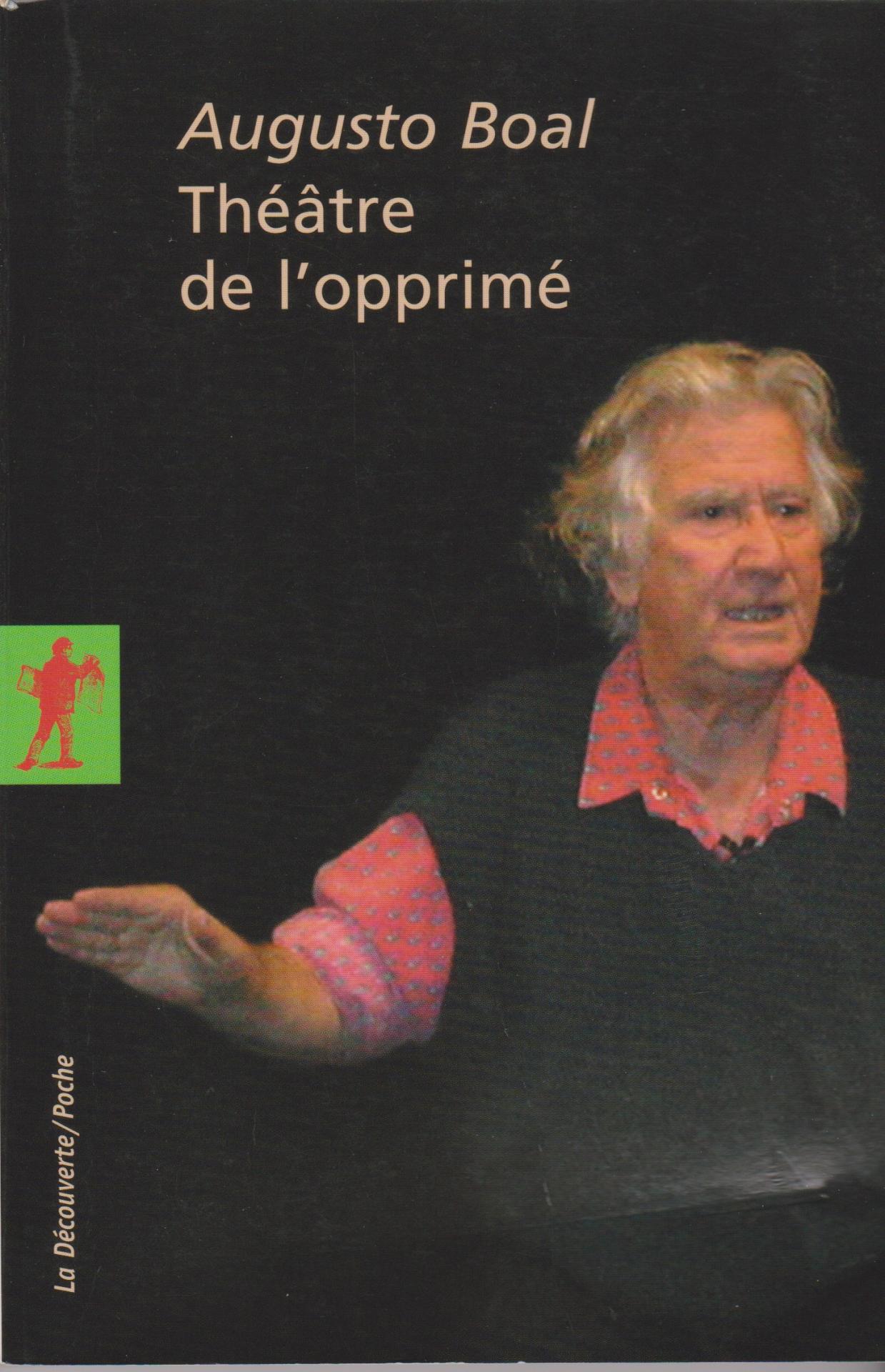
« Tout le monde peut faire du théâtre... même les acteurs... on peut faire du théâtre partout... même dans les théâtres... » A. Boal
Une autre façon de concevoir un théâtre centré sur la figure du spect-acteur que chacun, soignant ou soigné peut être. Un outil qui peut aussi bien être utilisé dans le cadre d'une médiation thérapeutique qu'en formation continue ou en colloque pour favoriser le moindre recours aux mesures coercitives.
« Voici les trois étapes [du théâtre-forum] : on demande d’abord à quelqu’un de raconter une histoire avec un problème politique ou social difficile à résoudre ; ensuite on répète ou on improvise directement pour donner un spectacle qui dure dix à quinze minutes et comporte la solution au problème posé ; à la fin du spectacle on ouvre le débat et on demande aux participants s’ils sont d’accord avec la solution proposée. Ils diront évidemment non. On leur explique alors qu’on va recommencer la scène une deuxième fois, exactement comme la première, mais que cette fois ceux qui ne sont pas d’accord peuvent venir remplacer l’acteur et mener l’action dans le sens qui leur semble le plus adéquat. L’acteur remplacé quitte le plateau et regarde, reprenant sa place dès que le joueur a terminé son intervention. Les autres acteurs doivent s’adapter à la nouvelle situation et envisager « à chaud » toutes les possibilités offertes par la nouvelle proposition. » (p.34)
L’auteur
Augusto Boal commence par faire des études de chimie qui le mènent au doctorat. Il mène en parallèle ses activités théâtrales. Il fonde en 1956, à 25 ans, le Théâtre Arena de Sao Paulo dont il devient directeur artistique et metteur en scène. Il y développe jusqu’aux coups d’état successifs de 1964 et 1968, à côté de mises en scène classiques, un théâtre populaire, de rue et contestataire dans lequel il développe le personnage du « spec-acteur ». Il est arrêté, torturé et contraint à l’exil, après avoir publié « Le théâtre de l’opprimé » (TO) en 1971. Accusé d’être un agent de liaison au profit des « subversifs », il est longuement interrogé, puis torturé. Après plusieurs semaines d’isolement, il est transféré vers la prisons de Tiradentes où, en compagnie d’autres prisonniers politiques, il découvre l’univers carcéral. Libéré grâce à une campagne de presse internationale, il poursuit son travail à Paris. On peut lire le récit de cet emprisonnement dans « Miracle au Brésil ».
Au cours de ces années soixante-dix, il voyage dans toute l’Amérique latine, expérimente diverses formes de théâtre participatif et éducatif. Il théorise sa pratique théâtrale et organise le premier festival du Théâtre de l’opprimé à Paris, en 1981. Il se penche sur le théâtre thérapeutique et ce qu’il nomme « le flic dans la tête ». Il consacre un ouvrage à cette expérience : « L’arc-en-ciel du désir » .
Il rentre à Rio de Janeiro, à la fin de la junte militaire (en 1986) et établit un Centre du Théâtre de l’opprimé et plusieurs compagnies qui mettent en pratique le théâtre forum et le théâtre image (expériences passionnantes dont nous pouvons largement nous inspirer). Elu législateur municipal sur la liste de gauche du Parti des Travailleurs de Lula, il entame une nouvelle expérience : le théâtre législatif, dispositif qui vise à proposer des lois élaborées par le peuple lui-même. Il meurt en mai 2009 à Rio.
« On a résolu ce problème [celui de l’a parte qui renseigne le public sur l’action], dans le système du joker, en utilisant des procédés pris aux rituels des compétitions sportives : pendant la mi-temps, les temps morts et autres arrêts accidentels du jeu, les journalistes interrogent athlètes et joueurs qui informent ainsi directement le public sur ce qui vient de se passer.
Ainsi, chaque fois qu’il est nécessaire de montrer la « face cachée » d’un personnage, le joker paralyse momentanément l’action pour que celui-ci s’explique. Dans ce cas, l’acteur interviewé devra réagir selon la conscience du personnage et ne pas laisser transparaître la sienne, « ici et maintenant ». » (p.73)
L’ouvrage
Ce livre, écrit pendant plusieurs années, au fil des expériences de Boal, constitue un véritable art poétique (ou politique) théâtral. Il est permis de le diviser en deux parties : les exemples concrets et la théorie du théâtre. Boal, et c’est ainsi que je me l’imagine, commence par décrire la pratique. Une expérience de théâtre populaire au Pérou propose une série d’exercices qui ont pour but de permettre au spectateur de devenir acteur et auteur de la pièce. Nous sommes à des années-lumière du théâtre « bourgeois » qui mythifie le personnage de l’AUTEUR et de l’ACTEUR. Le spectateur avec Boal joue et écrit lui-même la pièce. Aucun spectateur ne se muant spontanément en acteur/auteur, il faut l’y aider en utilisant divers procédés. Quatre étapes permettent à n’importe quel spectateur de devenir acteur puis auteur : connaissance de son corps, rendre son corps expressif, le théâtre comme langage, le théâtre comme discours. De nombreux exercices, souvent très astucieux, illustrent ces étapes. Boal les décrit et montre comment ils ont fonctionné dans des groupes réels. Le théâtre est pensé et vécu comme langage, comme moyen de connaissance et de transformation de la réalité intérieure, relationnelle et sociale. Il s'agit d'un théâtre qui rend le public actif et qui sert aux groupes de « spect-acteurs » à explorer, à mettre en scène, à analyser et à transformer la réalité qu'eux-mêmes vivent.
Boal propose de développer la théâtralité humaine dans le but d'analyser et de transformer les situations de malaise, de mal-être, de conflit, d'oppression, etc. Il adopte une attitude non d'endoctrinement mais de maïeutique : il ne donne pas de réponses mais pose des questions et créé des contextes utiles à la recherche de solutions élaborées par le collectif. Une de ses principales hypothèses de base est que « le corps pense », cela suppose une conception de l'être humain comme globalité de corps, d'esprit et d'émotion ou l'apprentissage/changement implique, en étroite relation, les trois aspects. Le TO évolue dans les limites entre le théâtre, l'éducation, la thérapie, l'intervention sociale et politique.
Tout en touchant des aspects personnels et émotifs, le TO ne se pose pas comme thérapie, mais comme instrument de « libération » collective s'appuyant sur la prise de conscience autonome des personnes, sur le « miroir multiple du regard des autres ». Une des figures les plus intéressantes explorées par Boal est celle du « joker » qui peut intervenir à tout moment dans une pièce afin d’expliquer les enjeux, de questionner les personnages, de modifier le déroulement de l’action, de donner la parole à tel ou tel spectateur.
La seconde partie de l’ouvrage est consacrée à la théorie du théâtre que sous-tendent ces diverses expériences et ces mille façons d’humaniser le spectateur (« mot obscène ») qui est moins qu’un homme. « Il doit être sujet, acteur, à égalité de condition avec les autres qui deviennent à leur tour spectateurs […] Les gens qui font du théâtre appartiennent en général, directement ou indirectement aux classes dominantes : leurs visions fermées seront donc celles des classes dominantes. […] Le peuple (dont les patients font partie) ne peut continuer à être la victime passive de ces images. »
« Une surprise est de voir à quel point les gens aiment jouer ce type de théâtre. Je suis d’accord pour reconnaître qu’il ne peut se substituer à l’action réelle. […] C’est un moyen, je crois, beaucoup plus riche que l’assemblée générale où, souvent, on dit des choses comme on en dirait d’autres. Ici on est forcé de les faire ; faire et dire, ce n’est pas la même chose. Faire avec toute sa sensibilité. On se voit se changeant tous. Faire devant les autres, ce n’est pas dire une phrase : le temps de la démagogie s’achève parce que l’action engage plus, que les autres sont présents pour dire non, ce que tu proposes est démagogique, ridicule. » (pp.187-188)
L’intérêt pour les soins
Les techniques prônées par Boal peuvent s’utiliser partout et en tout lieu : à l’IFSI, à l’hôpital, à l’usine. Qu’il s’agisse de permettre aux étudiants d’être actifs, de prendre leur collectif à bras le corps, qu’il s’agisse de travailler en réunion communautaire ou institutionnelle sur le fonctionnement de telle ou telle structure de soins, sur les conflits, la violence qui l’agite, on peut travailler à partir du théâtre.
A Serpsy, nous avons régulièrement utilisé ces techniques lors de nos colloques (statue d’équipe, théâtre forum, procès du soin, etc.). Leur effet d’entrainement est à chaque fois spectaculaire. Les soignants spectateurs souvent passifs se mobilisent, modifient les répliques, montent sur scène pour les jouer. Ils deviennent des spect-acteurs. Pour ceux qui souhaitent travailler sur le moindre recours à l’isolement et à la contention, le théâtre-forum et le joker constituent deux superbes outils qui invitent à dépasser le « On ne peut pas faire autrement » ou le « On manque de moyens ».
Les techniques du Théâtre de l’Opprimé peuvent également être utilisées dans le cadre d’une activité de médiation qui s’appuie sur le théâtre.
Le théâtre est politique et la politique est partout ! Vive le théâtre de l’opprimé !
Dominique Friard
Notes
1- BOAL (A), Théâtre de l’opprimé, Editions La Découverte & Syros, Paris, 1996.
2- BOAL (A), L’arc-en-ciel du désir. Du théâtre expérimental à la thérapie, La Découverte, Paris, 2002.
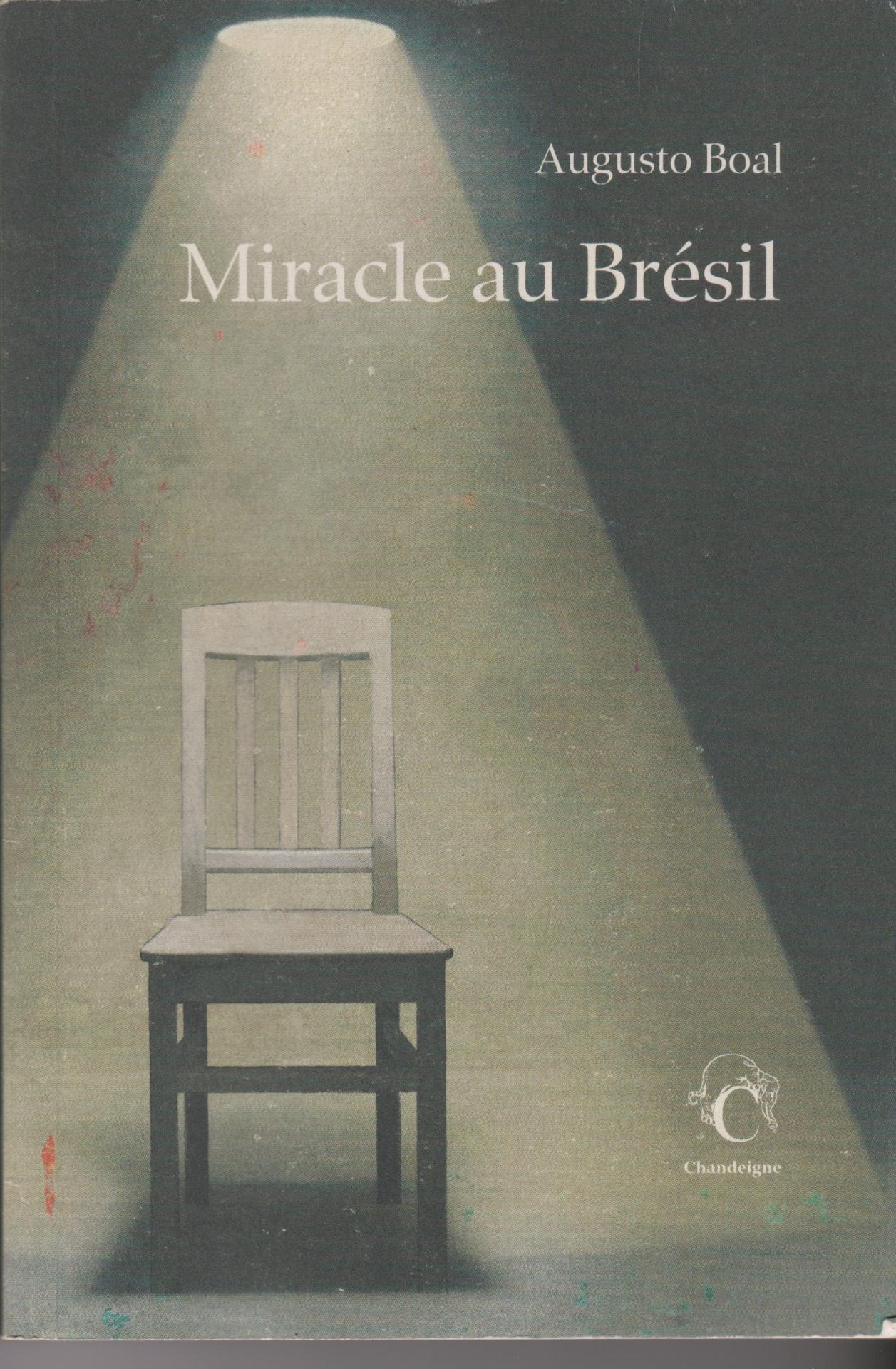
Date de dernière mise à jour : 16/02/2025
Ajouter un commentaire