Ehrenreich B., English D., Sorcières, sages-femmes & infirmières
Sorcières, sages-femmes & infirmières
Une histoirE des femmes soignantes
Barbara Ehrenreich, Deirdre English
Un essai qui a ouvert la voie à de nombreux travaux de recherche et prises de conscience sur les racines historiques de la professionnalisation du corps médical qui s’est effectué sur la relégation des savoirs féminins, et, aux Etats-Unis, sur la suppression de la profession de sage-femme.
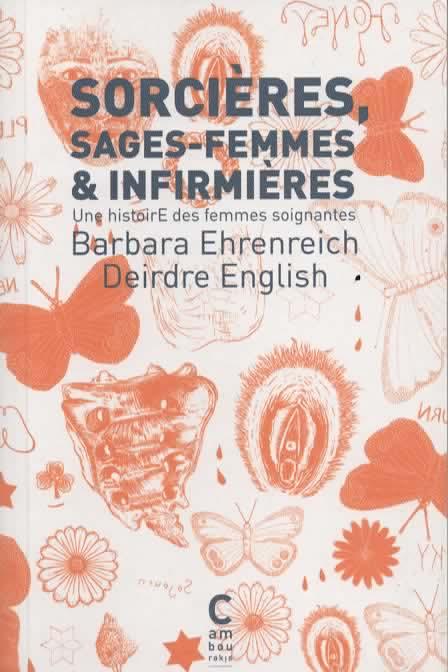
« Aux Etats-Unis, la prise de contrôle des fonctions de soignants par les hommes commença plus tardivement qu’en Angleterre ou en France, mais elle alla finalement beaucoup plus loin. Les Etats-Unis sont probablement le pays industrialisé ayant le plus faible pourcentage de femmes médecins : l’Angleterre en compte 24 %, la Russie 75 %, mais les Etats-Unis seulement 7 % (En 1973). Et alors que l’obstétrique -l’obstétrique pratiquée par des femmes- reste une activité prospère en Scandinavie, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, etc., elle a été pratiquement mise hors la loi aux Etats-Unis dès le début du XXème siècle. […] Il n’est resté aux femmes que la fonction d’infirmière, et ce n’était en aucune façon un substitut aux rôles autonomes qui avaient été les leurs comme sages-femmes et comme soignantes généralistes. »
Les autrices
Barbara Ehrenreich (1941-2022) est une écrivaine, chroniqueuse américaine, militante féministe. Elle a soutenu une thèse en chimie puis une autre sur l’immunologie cellulaire, elle a longtemps travaillé sur la santé et les femmes. C’est une grande figure des socialistes démocrates étatsuniens des années 1980 et 1990.
Au début des années 1970, elle rencontre Deirdre English (1948) au College at Old Westbury de l’Université d’Etat de New-York où elles sont toutes deux enseignantes. Militantes actives au Women’s Health Movement qui émerge, elles publient ensemble trois pamphlets qui exerceront une grande influence sur la pensée féministe concernant la chasse aux sorcières. Outre cet ouvrage, elles ont publié « Fragiles ou contagieuses. Le pouvoir médical et le corps des femmes » et « Des experts et des femmes. 150 ans de conseils prodigués aux femmes ».
« Nightingale et ses disciples immédiates marquèrent le métier d’infirmière de l’empreinte indélébile de leurs préjugés de classe. La formation insistait sur l’attitude plutôt que sur le savoir-faire. Le produit fini, l’infirmière façon Nightingale, était tout simplement la Dame idéale, transplantée de la maison à l’hôpital, et dispensée de la responsabilité de la reproduction. Au docteur, elle apportait la vertu d’obéissance absolue propre aux bonnes épouses. Aux patient.e.s, elle apportait le dévouement désintéressé d’une mère. Aux employé.e.s subalternes de l’hôpital, elle apportait la discipline ferme mais bienveillante d’une maîtresse de maison habitué à diriger des domestiques. »
L’ouvrage
Au-delà du soin en psychiatrie dont nous explorons régulièrement une histoire faite d’invisibilisation du côté infirmier et dans un moindre mesure du côté médical, existe l’histoire riche, complexe et genrée de la santé. L’une pas plus que l’autre n’est racontée.
La médecine est une grande pourvoyeuse de mythe, tel que celui de Pinel libérant les aliénés de leurs chaînes. Le pamphlet de Ehrenreich et English nous emmène dans un incertain voyage à travers le temps. Nous y voyons l’évolution du concept de soin, son façonnage par les forces sociales, les croyances culturelles et les atermoiements politiques des différentes époques. L’ouvrage comprend deux parties : « Sorcellerie et médecine au Moyen-Age » et « Les femmes et l’ascension de la profession médicale aux Etats-Unis. »
Chasse aux sorcières
Les deux autrices nous invitent à reconsidérer notre représentation des sorcières, elles nous rappellent qu’elles n’étaient pas systématiquement associées au mal mais souvent vénérées comme guérisseuses.
À travers des exemples concrets tirés des archives de procès, elles nous poussent à questionner les motivations sous-jacentes derrière l'étiquetage des guérisseuses en tant que sorcières, mettant en lumière la peur profonde et l'insécurité liées au fait que les femmes possédaient des connaissances et une autonomie dans une société profondément patriarcale.
Dans les temps anciens, les sages-femmes étaient vénérées en tant que femmes sages qui assistaient les futures mères au moment d'apporter la vie au monde. Leur connaissance intime des remèdes à base de plantes, des techniques apaisantes et de la sagesse traditionnelle en ont fait des ressources inestimables au sein de leurs communautés. Pourtant, avec l'évolution de la société et l'émergence de la science médicale comme force dominante, les sages-femmes se sont retrouvées marginalisées et rejetées comme de simples accoucheuses. L'avènement de l'obstétrique a imprégné la politique de genre, reléguant les sages-femmes à la périphérie des soins de santé.
La sorcière n’est pas accusée que de meurtre et d’empoisonnement, de crimes sexuels et de conspiration, mais aussi et peut-être surtout d’aider et de soigner. Ainsi que l’écrivait un chasseur de sorcières : « Il faudra toujours se souvenir que par sorciers et sorcières nous n’entendons pas seulement ceux et celles qui tuent et tourmentent, mais tous les devins et toutes les devineresses, les enchanteurs et enchanteresses, les bateleurs et les bateleuses, tous les magiciens et toutes les magiciennes, communément appelés « bons hommes » et « bonnes femmes » […] au nombre desquels nous comptons aussi tous les bons sorciers et toutes les bonnes sorcières, qui ne font pas de mal mais du bien, qui n’endommagent ni ne détruisent mais sauvent et délivrent […] Ce serait mille fois mieux pour le pays, si tous, et particulièrement les sorciers et les sorcières bienveillants pouvaient subir la mort. »
Ces femmes avaient acquis une compréhension fine de la médecine à base de plantes et des remèdes à base de plantes qui permettaient de traiter un grand nombre de maladies et d’affections. Leur savoir était transmis de générations en générations. Elles étaient capables de diagnostiquer et de traiter efficacement de nombreuses affections. Les sociétés dominées par les hommes percevaient ce savoir comme une menace. Ces femmes soignantes se voyaient accorder un certain niveau d’indépendance et d’autorité au sein de leur communauté. Elles pouvaient subvenir à leurs besoins et à ceux des autres sans avoir recours à une quelconque intervention masculine.
« Nommer sorcière celle qui revendique l'accès aux ressources naturelles, celle dont la survie ne dépend pas d'un mari, d’un père, d'un frère, celle qui ne se reproduit pas, celle qui soigne, celle qui sait ce que les autres ne savent pas, ou encore celle qui s'instruit, pense, vie et agit autrement, c'est vouloir activement éliminer les différences, tout signe d'insoumission et tout potentiel de révolte. C'est protéger coûte que coûte les relations patriarcales brutalement établies lors du passage du féodalisme au capitalisme. » (citation de Anna Colin, dans la post-face du livre)
Ainsi, les médecins anglais envoyèrent-ils une pétition au Parlement dans le but de dénoncer les « femmes présomptueuses et sans valeur qui usurpaient la profession » et de réclamer que toute femme qui tenterait de « pratiquer la fisique » se voie imposer des contraventions et de « longues peines de prison ». Cette campagne fut pratiquement close au XIVème siècle. Ainsi les médecins hommes conquirent-ils un monopole indiscutable sur l’exercice de la médecine au sein des classes dominantes (excepté pour l’obstétrique qui resta le domaine des sages-femmes même au sein des classes dominantes). Ils étaient prêts à jouer un rôle-clé dans l’élimination de la grande masse des femmes soignantes -les « sorcières ».
Le partenariat entre l’Eglise, l’Etat et la profession médicale s’épanouit dans les procès des sorcières. Le médecin devint l’expert qui donnait à toute la procédure une aura « scientifique ». « On lui demandait de juger si certaines femmes étaient des sorcières et si certaines affections avaient été causées par la sorcellerie. Le Malleus dit : « Et si l’on se demande comment il est possible de distinguer si une maladie est causée par la sorcellerie ou par quelque défaut physique naturel, nous répondons que la première (méthode) est le recours au jugement des docteurs ». » « Si une femme ose soigner sans avoir étudié, elle est une sorcière et doit mourir. »
Cet aspect de l’ouvrage a été remis en cause par nombre d’historiens (féministes ou non). Ainsi Diane Purkiss critique les erreurs factuelles contenues dans le livre, mais également sur un plan politique, il tend à poser ces femmes comme victimes impuissantes d’une société patriarcale ce qui ne favorise pas l’engagement dans les luttes féministes contemporaines. Elle relève également que certaines des femmes persécutées n’étaient ni sages-femmes, ni guérisseuses, dans certaines parties de l’Europe, ces catégories firent même partie des personnes encourageant la persécution.
La seconde partie, pour nous plus intéressante, n’a guère suscité de critiques (nous n’en avons pas trouvé).
La résistible ascension des médecins
En 1800, aux Etats-Unis, on trouvait peu de médecins officiellement diplômés (peu d’entre eux avaient émigré d’Europe). Il y avait très peu d’écoles de médecine et même peu d’institutions d’enseignement supérieur. Le grand public, fraîchement sorti d’une guerre de libération nationale, était hostile à la professionnalisation et à toute forme d’élitisme « étranger ». La médecine était ouverte à quiconque pouvait faire preuve de compétences en matière de soins -indépendamment d’une qualification formelle, de la race ou du sexe. Jusqu’en 1818, la pratique médicale était majoritairement aux mains des femmes. Au début du XIXème siècle, il se trouvait aussi un nombre croissant de docteurs en médecine diplômés. Ils se distinguaient par l’enseignement formel qu’ils avaient reçus. Les médecins « réguliers » comme ils se nommaient eux-mêmes étaient des hommes, généralement issus de la classe moyenne. Ils étaient toujours plus chers que leurs concurrents sans diplômes. Ils soignaient presqu’exclusivement des membres des classes moyennes ou supérieures qui pouvaient s’offrir le prestige d’être traités par un « gentilhomme » de leur propre classe. On leur enseignait à traiter la plupart des maladies par des mesures « héroïques » : saignées copieuses, laxatifs à haute dose, calomel, et plus tard opium. Leurs remèdes étaient souvent fatals. Les empiriques, au moins, ne nuisaient pas.
Ils réussirent, en 1830, dans treize états, à faire voter des lois pour réglementer l’exercice de la médecine, qui mettaient hors la loi les pratiques « irrégulières » et instituaient les « réguliers » comme seuls soignants légaux. Cette mesure prématurée suscita une indignation massive et radicale : les patients tenaient à leurs « irréguliers » qui étaient souvent des « irrégulières ».
Les autrices mettent en avant un mouvement massif quasi inconnu en France : le Mouvement Populaire pour la Santé (Popular Health Movement). Dans les histoires classiques de la médecine, ce mouvement qui prit de l’ampleur dans les années 1830-1840 est rapidement écarté comme constituant le sommet de la vague du charlatanisme et du sectarisme médical. Il s’agit d’un soulèvement social généralisé attisé par les mouvements féministe et ouvrier. Les femmes en étaient la colonne vertébrale. On vit fleurir partout des Sociétés de Physiologie de dames, l’équivalent de nos cours « Connaissez votre corps » qui enseignaient à des auditoires captivés des notions simples d’anatomie et d’hygiène personnelle. L’accent était mis sur les soins préventifs, en opposition aux remèdes meurtriers appliqués par les docteurs réguliers. Le Mouvement recommandait de prendre des bains fréquents (ce que nombre de médecins considéraient à l’époque comme un vice), de porter des vêtements féminins amples, de consommer des céréales complètes, de ne pas boire d’alcool et il soulevait tout un tas de questions qui concernaient les femmes dont la contraception.
Le Mouvement constituait une attaque radicale contre l’élitisme médical et un soutien à la médecine traditionnelle du peuple. Une des branches du Mouvement avait pour slogan « Chaque homme est son propre docteur » et il était clair dans son discours que chaque femme l’était également. Les « docteurs réguliers » diplômés étaient attaqués en tant que membres « des classes parasites et non productives » qui ne survivaient que grâce au « goût scabreux » de la classe dominante pour le calomel (sel de mercure utilisé comme purgatif et antiseptique intestinal) et les saignées. Les radicaux de la classe ouvrière se rallièrent à la cause en dénonçant les quatre grands fléaux de l’époque : « L’art de la Royauté », « L’art de la prêtrise », « L’art de la Loi » et « L’Art de la médecine ». Le Mouvement était représenté au Parlement.
Les « docteurs réguliers » se retrouvèrent vite surpassés et nombre et acculés. Pour l’aile gauche du mouvement, il n’était pas question que la pratique médicale puisse être rémunérée (et encore moins un profession surpayée). De l’aile modérée naquit une foule de nouvelles philosophies et de sectes qui entrèrent en compétition avec les « réguliers » sur leur propre terrain : l’éclectisme, le grahamisme, l’homéopathie et d’autres de moindre importance. Les nouvelles sectes ouvrirent leurs propres écoles de médecine et commencèrent à diplômer leurs propres médecins dont des femmes.
Profitant des dissensions au sein du Mouvement, les réguliers repassèrent à l’offensive. En 1848, ils constituèrent leur première organisation nationale l’Association Médicale Américaine (AMA). Pendant toute la fin du XIXème siècle, les « réguliers » attaquèrent inlassablement les praticiens empiriques, les docteurs des sectes médicales et les femmes praticiennes en général. On attaquait les femmes praticiennes parce qu’elles avaient été formées en école libre ; on attaquait les écoles libres parce qu’elles formaient des femmes. Les arguments contre les femmes docteures allaient du paternalisme (comment une femme respectable pourrait-elle se déplacer de nuit pour une urgence médicale ?) au sexisme le plus violent. La virulence de l’opposition sexiste envers les femmes aux Etats-Unis n’a pas eu d’équivalent en Europe (notamment en raison du grand nombre de féministes aux USA).
Le patronage des classes dirigeantes et les progrès de la science permirent aux professionnels « réguliers » de s’imposer. En 1893, des médecins formés en Allemagne (et subventionnés par des philanthrope locaux) fondèrent la première école de médecine « à l’allemande » des Etats-Unis, l’Université John-Hopkins qui intégra le travail de laboratoire à l’enseignement scientifique de base et augmenta la formation clinique. Le recrutement de professeurs à plein-temps, l’accent mis sur la recherche, une meilleure organisation du cursus de études médicales (quatre années d’école de médecine à la suite de quatre années d’université) augmenta considérablement les compétences des médecins mais rendit l’étude de la médecine quasiment inaccessible à la classe ouvrière et aux pauvres. Devenus la première nation industrielle du monde, les Etats-Unis favorisèrent la philanthropie. Des fondations furent créées pour être les instruments durables d’une réforme médicale et la création d’une profession médicale respectable et scientifique (fondation Carnegie et Rockefeller). A partir de 1903, l’argent des fondations commença à se déverser par millions sur les écoles de médecine. « Les conditions étaient claires : conformez-vous au modèle Johns-Hopkins ou fermez vos portes. Pour bien faire passer le message, la Carnegie Corporation envoya un émissaire de la maison Abraham Flexner, effectuer une tournée nationale des écoles de médecine, de Harvard jusqu’aux plus petites écoles commerciales de troisième catégorie. »
Le rapport Flexner, publié en 1910, fut l’ultimatum adressé par les fondations philanthropiques à la médecine états-uniennes. Dans son sillage les écoles de médecine fermèrent en nombre, notamment six des huit écoles pour les noirs et la majorité des écoles « régulières » qui avaient été un refuge pour les femmes étudiantes. Il est intéressant de noter que c’est dans ce contexte que Freud, Jung et Ferenczi débarquèrent aux Etats-Unis. Sous peine d’être considérée comme une secte, ou une pratique d’irréguliers, la psychanalyse ne pouvait que se ranger dans le giron médical et donc respecter le modèle Johns-Hopkins. Les procès qui furent intentés aux disciples émigrés de Freud pour exercice illégal de la médecine s’inscrivent dans ce mouvement. N’en déplaise aux contempteurs de la psychanalyse, elle fut donc bien considérée, par les médecins américains, comme une pratique scientifique (au sens où ils l’entendaient).
Fin des sages-femmes aux Etats-Unis
Il ne restait plus qu’à se débarrasser des dernières réfractaires de l’ancienne médecine populaire : les sages-femmes. En 1910, environ 50 % des accouchements étaient pratiqués par des sages-femmes. La plupart d’entre elles étaient des noires ou des immigrantes de la classe ouvrière. Elles furent rendues responsables de la fréquence de la septicémie puerpérale et de l’ophtalmie néonatale qui pouvaient être prévenues par le lavage des mains et des gouttes dans les yeux pour l’ophtalmie). Un peu de formation complémentaire aurait permis de les mettre à disposition, ce qui fut fait en Europe, le métier de sage-femme fut ainsi revalorisé. Une étude menée par un professeur de Johns-Hopkins avait montré, en 1912, qu’aux Etats-Unis, la plupart des médecins étaient moins compétents que les sages-femmes.
Les Etats, soumis à une intense pression de la part de la profession médicale, promulguèrent les uns après les autres des lois interdisant la pratique de l’obstétrique aux sages-femmes et la réservant aux médecins. Pour les femmes pauvres de la classe ouvrière, cela signifia une dégradation (voire une suppression) des soins obstétricaux. Une étude des taux de mortalité infantile à Washington montre un accroissement de cette mortalité dans les années qui suivirent immédiatement la promulgation de ces lois.
Les infirmières
Il ne restait plus aux femmes comme activité dans le domaine de la santé que les soins infirmiers. Au début du XIXème siècle, une « infirmière » était simplement une femme qui apportait des soins à quelqu’un -un enfant malade ou un parent âgé. Il y avait des hôpitaux et ils employaient des infirmières, mais ces hôpitaux servaient principalement d’asile aux indigents mourants, et les soins qui leur étaient prodigués étaient surtout symboliques.
Si la profession d’infirmière n’offrait pas un horizon attrayant pour les femmes de la classe ouvrière, elle constituait un terrain vierge pour les femmes réformatrices. « Pour une réforme des soins hospitaliers, il fallait réformer la fonction d’infirmière, et pour rendre cette fonction acceptable aux yeux des docteurs et des femmes de « bonne réputation », il fallait en donner une image entièrement neuve. »
Nightingale saisit l’occasion de la guerre de Crimée pour substituer aux vieilles cantinières qui faisaient office d’infirmières dans les hôpitaux de campagne une troupe de dames d’âge mûr, sobres et disciplinées. Aux Etats-Unis, pendant la guerre de Sécession, c’est Dorothea Dix, un réformatrice des hôpitaux, qui introduisit cette nouvelle sorte d’infirmières dans les hôpitaux des armées nordistes.
La nouvelle infirmière, la « dame à la lampe », « dévouée corps et âmes aux blessés » frappa l’imagination populaire. Des écoles d’infirmières commencèrent à s’ouvrir. Le nombre d’hôpitaux augmenta. « Les étudiants en médecine avaient besoin d’hôpitaux pour s’exercer ; les bons hôpitaux, comme les docteurs commençaient à le comprendre, avaient besoin de bonnes infirmières. »
« Observons d’un peu plus près ces femmes qui ont inventé le métier d’infirmière, parce que, très clairement ce métier tel que nous le connaissons aujourd’hui est le produit de leur oppression en tant que femmes de la classe dominante dans la société victorienne. Dorothea Dix était l’héritière d’une importante fortune. Florence Nightingale et Louisa Schuyler) l’élément moteur de la première école d’infirmières « de style Nightingale » aux Etats-Unis) étaient des aristocrates authentiques. Elles étaient des rescapées de l’oisiveté imposée aux femmes dans la société victorienne. Dix et Nightingale n’ont commencé leur carrière de réformatrices qu’après avoir dépassé la trentaine, confrontées à la perspective d’une longue et vaine existence de vieille fille. Elles consacrèrent leur énergie au soin des malades parce que c’était un intérêt « naturel » et acceptable pour des femmes de leur classe sociale. »
Il est tellement rare de lire un discours aussi critique sur ces saintes laïques que la profession infirmière en France ne cesse de chérir que je ne résiste pas au plaisir de citer d’autres passages.
« Nightingale et ses disciples immédiates marquèrent le métier d’infirmière de l’empreinte indélébile de leurs préjugés de classe. La formation insistait sur l’attitude plutôt que sur les savoir-faire. Le produit fini, l’infirmière façon Nightingale, était tout simplement la Dame idéale, transplantée de la maison à l’hôpital, et dispensée de la responsabilité de la reproduction. Au docteur, elle apportait la vertu d’obéissance absolue propre aux bonnes épouses. »
Mais en dépit de l’image séduisante, le travail d’infirmière est pénible, sale et fatiguant. Bientôt, la majorité des écoles d’infirmières n’attirèrent plus que des femmes de la classe ouvrière et de la classe moyenne inférieure. « La philosophie de la formation des infirmières ne changea pas [A-t-elle réellement changé ?] -après tout, les formatrices étaient toujours des femmes des classes moyennes et supérieures. Elles insistèrent même davantage encore sur le développement d’une attitude distinguée, et la socialisation des infirmières devint ce qu’elle a été pendant tout le XXème siècle : l’imposition des valeurs culturelles de la classe dominante aux femmes de la classe ouvrière. » Il y a là matière à de nombreux travaux pour valider ou non les affirmations de nos deux autrices.
« L’infirmière façon Nightingale ne symbolisait pas uniquement la projection de la condition féminine de la classe dominante dans le monde du travail : elle incarnait le véritable esprit de la féminité telle que la société victorienne sexiste l’avait définie -elle était la femme. Celles qui inventèrent le métier d’infirmière le voyaient comme une vocation naturelle pour les femmes juste après la maternité. Lorsqu’un groupe d’infirmières anglaises proposa d’aligner le métier d’infirmière sur la profession médicale, avec des examens et des diplômes, Nightingale répondit que « les infirmières ne sauraient s’inscrire ni passer des examens, pas plus que les mères » »
Le pire est que les féministes de l’époque adhérèrent à ce discours, ce que réprouvent nos deux autrices.
« Le mouvement féministe renonça à son combat initial, l’ouverture des professions aux femmes. Pourquoi abandonner la Maternité pour les activités insignifiantes des hommes ? L’entrain avec lequel elles dénonçaient la professionnalisation comme intrinsèquement sexiste et élitiste était mort depuis longtemps. Au lieu de cela, elles se mirent à vouloir professionnaliser les fonctions traditionnelles des femmes. Le travail ménager devint une nouvelle discipline séduisante, les « sciences domestiques ». La maternité fut vantée comme une vocation qui nécessite autant de préparation et de savoir-faire que le métier d’infirmière ou d’enseignement. »
Que dire de la désastreuse appellation de « sciences infirmières » dans un tel contexte ? « Cette volonté de « professionnaliser » le métier d’infirmier équivaut, au mieux, à fuir la réalité du sexisme dans le système de santé. Au pire, il s’agit d’une démarche en elle-même sexiste, en ce qu’elle creuse encore les divisions entre les travailleuses de la santé et conforte une hiérarchie contrôlée par les hommes. » En quoi, les pratiques des IPA sont-elles avancées ? En ce qu’elles se rapprochent des pratiques médicales. Les pratiques simplement infirmières, même appuyées sur des travaux de recherche, restent des pratiques non avancées.
L’intérêt pour les soins
La lecture de ce pamphlet, avec ses limites parfois, est revigorante. Elle fait du bien. Elle me fait du bien. Nous sommes trop gentilles, trop braves. Jamais une critique, ou alors voilée, très voilée. Il existe peu de chances qu’il trouve un chemin vers une université de sciences infirmières (sauf dans les cours de Dave Holmes ou d’Amélie Perron et de quelques rares autres).
Au moins, si vous m’avez suivi jusqu’ici, l’aurez-vous lu. A vous de le critiquer, de vérifier les informations, et de cheminer à votre rythme.
Dominique Friard
Date de dernière mise à jour : 15/08/2024
Ajouter un commentaire