Origgi G., Qu'est-ce que la confiance ?
« Qu’est-ce que la confiance ? »
Gloria Origgi
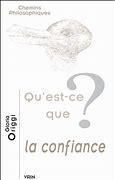
Une approche philosophique de la confiance qui repose sur les relations affectives et de pouvoir qui conditionnent nos actions et nos liens aux autres.
« C’est plutôt dans les sciences sociales contemporaines -notamment en sociologie politique, en économie, en psychologie sociale que cette notion [la confiance] a été largement débattue. Formalisée en économie en termes de réduction des coûts des transactions commerciales, invoquée en politique comme fondement de la démocratie, la confiance est souvent introduite dans l’explication des interactions sociales, mais sans être elle-même expliquée. Pourtant la portée philosophique de cette notion est claire : la confiance est l’endroit charnière entre connaissance, affects et engagements, le liant même de notre existence en tant qu’êtres sociaux. » (pp. 13-14)
L’autrice
Gloria Origgi philosophe italienne, née en 1967, est chargée de recherche au CNRS et à l’Institut Jean Nicod. Elle soutient une Habilitation à diriger des recherches (HDR) en 2013 avec comme sujet De la confiance à la réputation en épistémologie sociale. Elle s’intéresse à la philosophie de l’esprit, l’épistémologie sociale donc, la philosophie des sciences sociales et aux sciences cognitives appliquées aux nouvelles technologies. Elle a rédigé plusieurs articles sur les notions de confiance épistémique, déférence et autorité intellectuelle. Elle a publié, outre cet ouvrage sur la confiance, un livre sur l’impact des nouvelles technologies sur l’écriture Text-e : The Future of Text in Internet (Palgrave, 2007). En 2015, Origgi analyse comment une réputation se fait ou se défait (La réputation : qui dit quoi de qui ?). Elle illustre son propos par trois études particulières : la réputation sur Internet, la réputation du vin et la réputation académique.
En 2019, elle publie « Passions sociales », ouvrage qu’elle dirige et réunit de nombreux chercheurs et chercheuses. L’objectif de ce dictionnaire est d’étudier le rôle des passions en tant que mobiles de l’action sociale et politique à la lumière des théories contemporaines de l’action collective. « Cela amène aussi à réfléchir à la façon dont les émotions sont susceptibles d’être manipulées ou canalisées ». En 2024, elle rédige « La vérité est une question politique ».
« Russell Hardin propose un définition en termes d’enchâssement d’intérêts (en anglais : encapsuled interest) : je fais confiance à quelqu’un si j’ai des raisons de croire qu’il sera dans son intérêt de prendre en compte mes intérêts. Lorsque nous faisons confiance nous avons une attente rationnelle, qui porte non seulement sur l’action future de l’autre mais aussi sur les raisons de cette action, c’est-à-dire sur les raisons que l’autre personne a d’honorer notre confiance, car nous croyons qu’il est dans son intérêt de maximiser notre utilité. Les raisons que peut avoir le bénéficiaire de notre confiance peuvent varier selon le contexte et sont dans une certaine mesure indépendante des vertus et des dispositions psychologiques de la personne : une situation d’interaction peut contraindre les participants à une coopération en l’absence de toute morale ou disposition psychologique […] » (pp. 17-18)
L’ouvrage
S’il est vrai que les conduites à tenir proposées dans les IFSI nous serinent toutes de créer une relation de confiance avec le patient, elles nous expliquent rarement comment créer ce type de relation avec une personne qui interprète les autres à partir d’une projection de type psychotique. Le premier escroc venu serait probablement plus enseignant … mais est-il digne de confiance ? Les psychotiques n’ont pas besoin de faire confiance, ils savent contre toute évidence. Ils sont convaincus. Cette conviction est même un des cinq critères sémiologiques qui attestent d’un délire.
Telle n’est pas l’approche de la philosophe Gloria Origgi. Par la confiance, « nous donnons aux autres un certain pouvoir sur nous, et de la sorte », dit-elle, « nous nous mettons vis-à-vis d’eux dans un état de vulnérabilité. » Concept-clé pour comprendre nos actions sociales et morales, la confiance est une des notions les plus difficiles à traiter pour la philosophie et les sciences sociales. Selon les auteurs la confiance sera définie comme un état de croyance, un acte d’engagement ou comme un sentiment. Elle désigne soit la qualité d’une relation interpersonnelle (individuel ou institutionnel), soit l’action de s’engager dans une action risquée, soit enfin la motivation qui mène à cette action. Rajoutons que la confiance en soi renvoie à d’autres mécanismes.
Négligé par la philosophie, le concept s’est épanoui en sociologie politique, en économie et en psychologie sociale. Il est aujourd’hui appréhendé par la philosophie via quatre axes d’investigation : ses dimensions cognitive et rationnelle, affective et morale, épistémique et politique. La quête de raisons mène à une impasse. La valeur d’une relation de confiance va au-delà du simple calcul rationnel et met en jeu un ensemble de dispositions morales et psychologiques et des situations sociales dans lesquelles cette relation est entremêlée. L’opinion que l’on a de soi, le désir de familiarité, les engagements préalables constituent toujours l’arrière-plan de la confiance. Emotions, dispositions psychologiques et normes sociales conditionnent nos actes de confiance, ainsi que notre capacité à répondre aux attentes des autres à notre égard bien au-delà de notre choix rationnel. Si la confiance implique une responsabilité, il faut bien qu’existe une dimension cognitive accessible nous serions sinon en proie à une soumission aveugle aux normes sociales ou à des réactions émotionnelles incontrôlées. La dimension épistémique de la confiance est donc essentielle dans notre vie quotidienne. Mais comment avoir confiance dans la parole de l’autre ? Adler repère quatre critères de fiabilité qui seraient presque toujours présents dans l’évaluation d’un témoignage : l’expérience passée de la fiabilité dans une certaine pratique d’acquisition d’information, les contraintes sociales et institutionnelles sur la réputation, la compétence dans les pratiques conversationnelles et les intuitions sur la plausibilité préalable d’une information. Autrement dit, je serai fiable si je l’ai déjà été, si la personne (le patient par exemple) a pu en faire l’expérience. Je le serai en fonction de ma réputation, soit sur ce que les autres affirment à mon sujet (par exemple les autres patients ou mes collègues). Si j’ai la capacité de tenir un discours clair et intelligible qui sera garant de ma sincérité et de l’exactitude de ce que j’affirme.
L’ouvrage, parfois complexe, ne trône pas au milieu de l’azur, il aborde aussi des questions contemporaines : « Faut-il se fier aux gouvernants ? », « Peut-on faire confiance à Internet ? ». A méditer.
« Ce sont les femmes, selon Baier, qui mettent en premier plan les relations de confiance dans lesquelles on se trouve impliqué au quotidien, ce sont elles qui voient dans la confiance quelque chose qui va au-delà des droits et des devoirs. Ce sont les femmes encore qui ont connu et connaissent une grande quantité de relations de confiance non choisies librement. Parce qu’elles ont eu et ont encore souvent l’expérience des rapports inégaux de pouvoir, avec des plus faibles et des plus forts, elles ne voient pas l’égalité comme la seule condition qui permette d’instaurer la confiance. » (pp. 125-126)
L’intérêt pour les soignants
En tant que soignants nous appréhendons la confiance du côté de l’alliance thérapeutique et assez peu du côté des théories philosophiques qui permettent de penser le phénomène. D’une façon ou d’une autre, la confiance structure l’ensemble des interactions hospitalières et le soin d’une manière générale. Habituons-nous à penser la confiance dans ses dimensions cognitive et rationnelle, affective et morale, épistémique et politique. Elle ne va jamais de soi. Elle n’est jamais un dû. Quelle confiance accordons-nous à notre employeur l’Etat ? Au médecin qui dispense (ou non) l’essentiel des références cliniques qui structurent l’équipe ? Au patient lui-même ? A nous-mêmes individuellement ou en tant que collectif ?
Dominique Friard
Notes :
1- ORIGGI (G), Qu’est-ce que la confiance ? Vrin, Paris, 2008.
Date de dernière mise à jour : 19/02/2025
Ajouter un commentaire